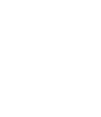Chil OSTROWIECKI
par son fils Henri Ostrowiecki
Pourquoi n’es-tu plus là ? D’ailleurs, aussi loin qu’il me soit possible de plonger dans ma mémoire, tu n’as jamais été présent. En fait, je n’ai aucune trace de toi, ni de ton visage, ni de ton sourire. Rien. Jamais, tu n’as été ce père dont parlent les enfants lorsqu’ils veulent exprimer leur fierté ou tout simplement être dans ce désir simple de lui donner la main, de lui ressembler, de te ressembler. “Oui d’abord, mon père c’est le meilleur, c’est le plus fort, le plus grand…” ; cette phrase, je suis sûr de ne l’avoir jamais prononcée, ni même pensée.
Des mots, toujours des mots ! Mais de quel poids peuvent-ils bien peser face à cette brutale réalité qui subitement a tout fait basculer ? Comment parler de quelqu’un qui n’a pour seule réalité que la fragile imagination ? Même la colère ne parvient pas à se frayer un chemin pour hurler à l’injustice. Car ma mémoire, “vieille” de trois ans et demi seulement au moment des faits, n’a pas été capable d’enregistrer l’événement qui est à l’origine de ta perte, de ta disparition. Événement qui aurait pu me convaincre que cet homme avait eu un fils et que ce fils, c’était moi. Tous ces mots viennent se fracasser contre le mur de ton absence.
Quelquefois, il me prend l’envie de t’imaginer dans la vie, la vraie avec ta voix, ton caractère, avec tes éclats de rires, tes colères, tes coups de gueule pas forcément envers moi. Quels étaient tes rapports avec Chaja, ta femme et aussi ma mère ? Comment peut-on inventer à partir de rien et de toutes pièces la personnalité de quelqu’un dont on ne connaît que le visage immobile grâce à quelques photos ? Est-ce seulement possible ? Toutes les pistes me sont offertes. Laquelle choisir ? Je me sens dans l’impasse. Tous mes efforts ne font qu’accentuer l’absurdité d’une telle tentative.
Et pourtant, c’est bien la première fois, après tant d’années, qu’il me prend cette envie, peut-être même ce besoin de t’interpeller, de m’adresser à toi directement, aussi familièrement, comme si tu avais ce don insensé de bousculer le temps et pourquoi pas le désir d’être près de moi, j’ai tellement envie de le penser. Comme si les mots avaient ce pouvoir de te ramener à la réalité. Je veux t’imaginer avec de larges épaules, plutôt grand, enfin plus grand que moi avec mon modeste mètre soixante-six. Je te vois avec un léger sourire aux lèvres, t’appuyant avec affection sur mes épaules pour lire ce que je suis en train d’écrire te concernant. Malgré les années, j’ai encore et toujours besoin de ta présence qui, malheureusement, n’a fait qu’effleurer ma vie. Ton absence m’est résolument insupportable, car en la matière, le temps n’a que peu de prises sur la réalité. Ainsi, par la force des choses, les mâchoires serrées, j’ai dû accepter que plus jamais tu ne serais présent à mes côtés. Et pourtant, j’aurais tant aimé ressentir le poids lourdement chaleureux de ton bras, sentir ton souffle me caresser la nuque, entendre ta voix. Mais voilà, tu as disparu de ma vie avant même que nous ayons eu le temps de faire davantage connaissance.
Pour modeler ton visage, j’ai dû utiliser quelques rares photos récupérées ici ou là après la guerre. Pour l’heure, nous sommes le 14 mai 1941. L’histoire de ton arrestation ainsi que les faits qui s’y rattachent m’ont évidemment tous été racontés. De toi, de ta réalité physique, je ne sais RIEN, ne connais rien, pas même le son de ta voix. Comment était-elle ? Quel timbre avait-elle ? Grave ? Je l’imagine plutôt douce ? En quelle langue me parlais-tu ? Très sûrement en yiddish. Je connais encore moins la lueur de ton regard. De quelle couleur étaient tes yeux ? Sans doute étaient-ils bleus comme les miens ?
Je n’ai gardé de ta présence, pour tout dire de ton existence, que la sensation d’un souvenir, un bref et chaud contact de tes genoux contre mes hanches dont la durée pourrait se mesurer en secondes. Mais quelles secondes ! Comme beaucoup de Juifs polonais, fraîchement émigrés, tu exerçais le métier de tailleur à domicile. Ainsi, dans l’appartement de deux pièces situé au 14 de la rue Delaître dans le 20e arrondissement qui te servait d’atelier, et que nous occupions tous les trois avec ta femme Chaja, il y avait dans l’une d’elles l’incontournable machine à coudre. Intrigué par le cliquetis et le va-et-vient de l’aiguille, je me revois debout devant la machine, bien calé entre tes genoux le dos confortablement appuyé contre ta poitrine. Fasciné par le mouvement de ce mystérieux mécanisme, j’ai dû avancer mon doigt jusqu’à vouloir toucher l’aiguille en action. C’est alors que j’ai senti la pression de tes genoux contre mes hanches juste au moment où mon doigt allait heurter l’aiguille. Voilà comment sans cet incident, ce banal petit fait, tu serais resté, toi mon père, un total inconnu, un immense vide. Plus tard avec les années, le souvenir de ce geste m’a permis de t’imaginer avec les plus belles qualités, souriant, doux, affectueux, attentionné, un homme auprès de qui j’aurais tant aimé grandir, vivre. Cet infime souvenir, presque dérisoire, prit la saveur d’un immense cadeau qui, dans les jours de trop grande tristesse, était là pour me rappeler que moi aussi, j’avais eu un père.
Ton arrestation a eu lieu le 14 mai 1941 au cours d’une opération de police improprement qualifiée “rafle du billet vert”, qui ne concernait que les hommes, juifs étrangers. Plusieurs milliers de ces hommes furent arrêtés au cours de cette opération pour avoir répondu en toute bonne foi à la convocation. Tous ceux qui avaient reçu cette petite feuille de couleur verte devaient se présenter aux Autorités accompagnés d’un membre de leur famille. C’est ton frère Moïshe, celui qui deviendra plus tard mon tuteur, qui se rendra avec toi au commissariat sans se douter un seul instant qu’il s’agissait d’une arrestation. Ensuite, tu seras interné au camp de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Quelques mois passent et le 4 août 1941, tu t’évades pour venir nous voir. Tout naturellement, tu te rends à Gentilly chez Moïshe qui te conseille de ne pas rester là et d’aller plutôt à Villejuif, chez un ami de la famille, où tu seras plus en sécurité. Mais un jour, n’y tenant plus, tu sors de ta cachette pour venir nous voir. C’est vraisemblablement à la sortie du métro Ménilmontant qu’à la suite d’un contrôle d’identité, tu es de nouveau arrêté. À partir du 23 août, tu seras interné au camp de Compiègne jusqu’à ton départ pour Auschwitz. Huit mois d’internement en France dont je ne saurai jamais rien ; as-tu vu ta femme Chaja, m’as-tu serré une fois encore dans tes bras, embrassé ? Autant de questions qui resteront définitivement sans réponse.
Le 27 mars 1942, c’est le départ du premier convoi pour Auschwitz. Le seul constitué de wagons de voyageurs de 3e classe et uniquement composé d’hommes, 1112, 19 seulement reviendront.
Il me faudra attendre la fin de la guerre pour découvrir ton sourire, grâce à trois photos dentelées trouvées dans un sac à main de ta femme Chaja, sauvées par hasard du désastre dont elle ne reviendra pas. Nous avons été arrêtés, elle et moi, lors de la rafle du Vel’ d’Hiv, le 16 juillet 1942 ce funeste jeudi noir. Moi seul, j’ai été sauvé, grâce à la rougeole, maladie contagieuse qui a nécessité mon hospitalisation à l’hôpital Rothschild. Elle sera déportée de Drancy le 14 septembre par le 32e convoi. C’est uniquement grâce à ces trois petites images, fragiles, presque désuètes, que Maman et toi n’êtes pas devenus des êtres sans visages. C’est la première fois depuis soixante-six ans que j’ose ainsi interpeller, appeler ma mère : Maman. Nos échanges se faisaient-ils en français ou en Yiddish ? Curieuse alchimie que celle des mots qui nous permettent à travers le temps de recréer un semblant de présence, une illusion. Je me surprends à avoir envie de la toucher. Auparavant, il m’avait fallu attendre la naissance de ma fille en 1965 pour que je puisse à nouveau articuler ces deux syllabes qui avaient quitté mon vocabulaire vingt-trois ans auparavant.
Pendant des années, ces photos m’ont accompagné, m’ont collé à la peau, je les ai gardées sur moi, contre moi, bien au chaud dans l’une des poches de mon pantalon (je peux même dire laquelle !), comme si leurs contacts allaient me restituer un peu de votre présence, de votre chaleur. Elles m’ont permis de vous imaginer, elles m’ont surtout aidé à recréer un semblant d’univers familial, de faire comme si… Sur l’une d’elles, tu es accroupi, me tenant bien serré contre toi. Un léger sourire éclaire ton visage, l’ambiance est paisible, douce, champêtre. Ce qui impressionne au premier regard, c’est l’abondance de ta chevelure châtain foncé, ondulée, qui s’élève par crans successifs au-dessus de ta tête que tu portes avec majesté. Merci à toi, papa, d’avoir eu la délicatesse, l’élégance de me la transmettre. Sur la deuxième, on me voit dans une poussette, Chaja se tient debout, son visage est grave, elle semble intimidée par l’objectif. La troisième est l’unique photo où nous sommes tous les trois en famille, en compagnie de ma tante Czarna, ta belle-sœur, la femme de Moïshe. Mais où sont leurs voix, leurs rires, leur amour, leurs baisers ? Où sont-ils ?
Très récemment, mon cousin Henri avec qui j’ai grandi a retrouvé une ancienne photo de toi, peut-être la plus ancienne, tu portes ta petite nièce, ma cousine Sylvia dans tes bras ; c’est la fille de ton frère, elle n’a que quelques mois. J’en déduis facilement que tu dois avoir autour de vingt-cinq ans. Le sourire que tu arbores m’a littéralement bouleversé, tu dégages un tel calme que l’on a immédiatement envie de t’approcher, d’être près de toi, de te parler. C’est alors que je suis submergé par une crise de larmes dans laquelle se mêlent colère, tendresse, impuissance, te toucher : voilà mon désir, sentir que tu existes. Un chapelet de pourquoi vient m’envahir, mais il vient comme toujours se fracasser contre le mur de la réalité. Cette colère, vers qui est-elle dirigée ? Contre toi, contre moi, contre tous, contre la terre entière ? Mais très vite, j’essuie mes yeux et la vie reprend ses droits.
Je tiens de mon oncle Moïshe l’unique histoire de Chil enfant, qui devait avoir alors entre huit et dix ans. Il était le plus jeune d’une fratrie de onze frères et sœurs issus de deux mariages. Moïshe se faisait toujours un plaisir de raconter comment son petit frère de onze ans son cadet avait fait connaissance avec la vodka. Mon grand-père, comme beaucoup de Polonais, avait pour habitude, avant de commencer la journée, de boire chaque matin et à jeun son petit verre de ce délicieux breuvage de sa fabrication, donc avec un degré alcoolique sans rapport avec la légalité, dans lequel il ajoutait une bonne pincée de poivre, histoire de lui donner encore un peu plus de goût. Cette recette était, disait-il, le secret de sa robuste santé ! Un matin, mon père curieux de connaître ce qui faisait les délices de son père, décida d’y goûter. Il attendit que la pièce soit vide, prit le verre laissé sur la table, au fond duquel ne restaient que quelques gouttes de vodka mélangée à un solide fond de poivre et le vida d’un trait. Imaginez la suite ! Mon père se mit à courir dans toute la maison en poussant des hurlements comme s’il venait d’avaler une poignée d’épingles. Chaque fois que mon oncle racontait cette histoire, il en pleurait de rire en se tapant joyeusement sur les cuisses. Mon seul regret a toujours été de ne connaître que cette anecdote, du moins c’est la seule dont je me souviens.
J’ai beau fouiller un à un dans les moindres méandres de ma mémoire, elle reste désespérément vide de tout autre souvenir. Ce constat m’a amené à accepter ce vide, cette absence, cette béance. À partir de là, j’ai développé une attitude face à la vie qui devint une stratégie, ou plutôt c’est elle qui s’est imposée à moi comme une évidence ; ne jamais regarder derrière soi au risque fatal de trébucher.
Montreuil, le 26 octobre 2008 (relu le 3 septembre 2011)
CHIL OSTROWIECKI
Interné au camp de Beaune-la-Rolande à partir du 14 mai 1941
Evadé le 4 août 1941
Déporté à Auschwitz le 27 mars 1942 par le convoi 1
Assassiné à Auschwitz
HENRI OSTROWIECKI
Fils de Chil Ostrowiecki
Né le 29 septembre 1937 à Paris 12e
-

Première page du livret de la famille Ostrowiecki : Chil et Chaja se marient le 10 juin 1937 à Paris. Archives familiales
-

Chil et Chaja Ostrowiecki (1937 ou 1938, sl). Archives familiales
-

Chaja Ostrowiecki et son fils Henri au début de l’année 1938 (sl). Archives familiales
-

Chaja Ostrowiecki et son fils Henri (printemps ou été 1939, sl). Archives familiales
-

Chil Ostrowiecki et son fils Henri (1939 ?, sl). Archives familiales
-

La famille Ostrowiecki, Chil, Chaja, leur fils Henri et, à droite, la tante Czarna (1939 ?, sl). Archives familiales
-

Henri Ostrowiecki (sd, sl). Archives familiales
-

Pages du livret de la famille Ostrowiecki : Chil et Chaja sont déclarés décédés. C’est le jour de leur déportation qui est indiqué comme date de décès, Drancy-sur-Seine en est le lieu. Archives familiales